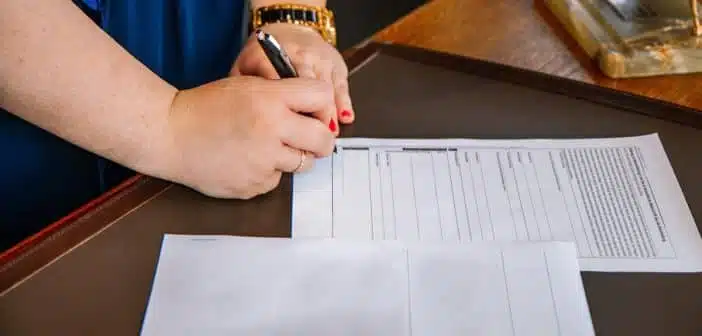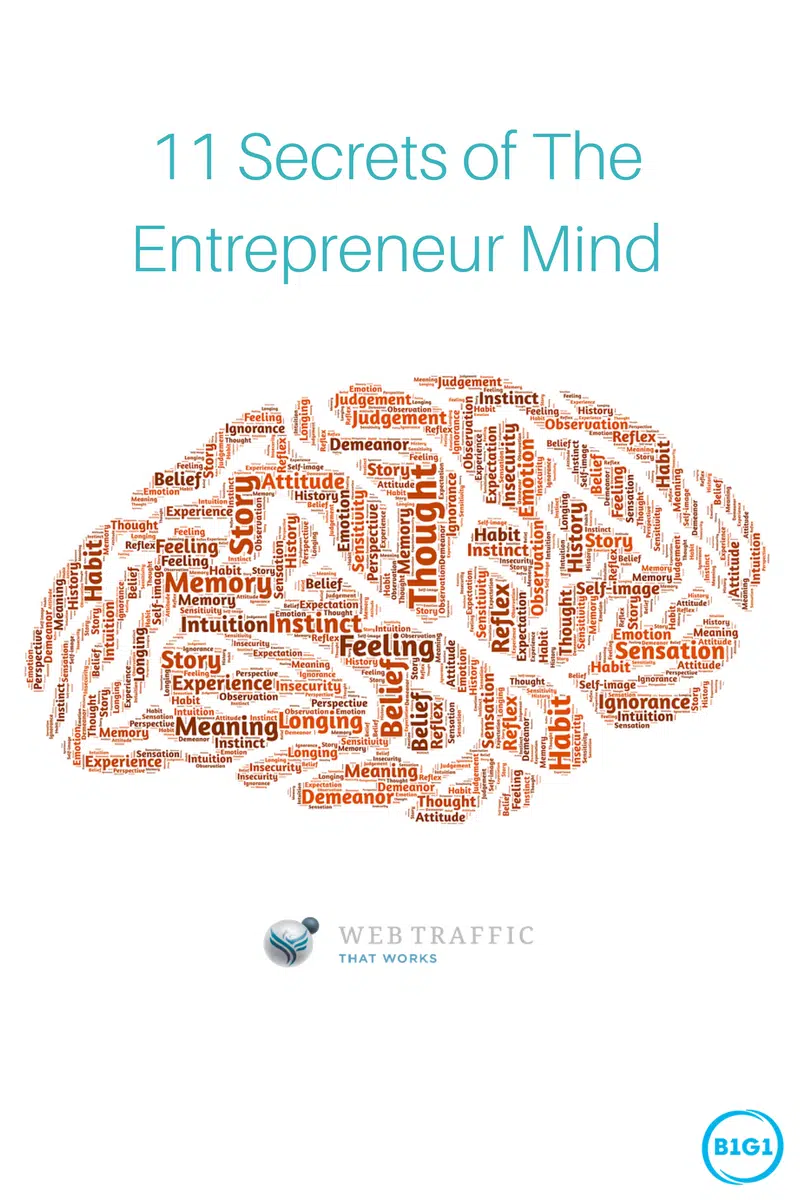3,7 millions de résidences secondaires : ce chiffre sec, sans détour, en dit long sur la place que tiennent ces biens dans le paysage français. Depuis 2015, un dispositif fiscal particulier s’est invité à la table : la surtaxe sur la taxe d’habitation, appliquée dans les communes où trouver un logement relève du parcours du combattant. Peu de propriétaires en connaissent les subtilités, d’autant que la règle varie au gré des conseils municipaux et des décrets. Une mesure qui ne laisse personne indifférent, surtout là où le soleil attire, où la mer scintille… et où le foncier se raréfie.
Si certaines stations balnéaires et cités touristiques échappent à cette surtaxe, c’est souvent à cause de critères démographiques précis ou d’une volonté politique locale. Le montant du supplément dépend directement de la taxe d’habitation de départ et du taux décidé par la mairie. Résultat : deux propriétaires, deux communes, deux additions parfois diamétralement opposées.
Pourquoi la surtaxe sur les résidences secondaires a-t-elle été instaurée en France ?
Depuis 2023, la résidence principale est sortie du radar de la taxe d’habitation. En revanche, les résidences secondaires restent dans le viseur fiscal, et parfois la facture grimpe en flèche. Ce choix découle d’une intention assumée : renforcer les capacités des communes qui doivent absorber la flambée des prix, tout en freinant la spéculation immobilière qui laisse trop d’habitants sur le carreau.
D’ici 2025, ces biens avoisineront les 3,7 millions, soit près de 10 % du parc immobilier total en France. Dans certains coins, ce pourcentage explose même : sur certaines côtes, en montagne ou dans les stations très touristiques, près d’un logement sur trois est une résidence de villégiature. On comprend alors pourquoi la tension locative monte, et pourquoi loger toute l’année relève de plus en plus du casse-tête.
Le but affiché de la surtaxe est double : doper les finances des municipalités et rééquilibrer l’accès au logement sur leur sol. Rien qu’en 2024, cette mesure a permis de collecter 3,2 milliards d’euros. Tous ceux qui possèdent, louent en meublé ou détiennent un droit sur un logement secondaire sont concernés. Derrière la ligne budgétaire, une consigne implicite : choisir la résidence secondaire engage dorénavant bien plus que le simple plaisir d’une échappée régulière.
Les communes concernées et les critères d’application : ce qu’il faut savoir
En réalité, toutes les communes ne sont pas logées à la même enseigne. Seules celles considérées comme « zones tendues », là où décrocher une location annuelle devient mission quasi impossible, ont la main sur cette surtaxe. La progression est notable : 1 628 communes vont l’appliquer en 2025, contre 1 461 un an avant, ce qui en dit long sur la pression immobilière dans certains secteurs.
Être classée zone tendue revient à répondre à deux critères : une demande de logements qui explose face à une offre insuffisante, et une reconnaissance officielle par décret. On retrouve dans ce périmètre de nombreuses stations du littoral, des vallées alpines ou pyrénéennes, et des métropoles comme Marseille.
Plusieurs exemples permettent de saisir l’ampleur du phénomène :
- À Roquebrune-sur-Argens, Saint-Tropez ou La Ciotat, le taux grimpe jusqu’à 60 %.
- Du côté de la Bretagne, Dinard se distingue aussi avec une hausse notable du taux voté.
- En Occitanie, environ 500 000 habitations, soit 13,5 % du parc, sont des résidences secondaires.
C’est le conseil municipal qui tranche sur le taux, entre 5 et 60 %. Ce qui explique la grande diversité des situations : un littoral et certaines villes touristiques imposent de fortes majorations, alors que dans d’autres territoires ruraux, les communes labellisées « France ruralités revitalisation » peuvent offrir des exonérations, en particulier pour des meublés de tourisme ou des chambres d’hôtes.
Ce dispositif s’accompagne aussi d’une taxation accrue sur les logements vacants, applicable si le bien n’a pas été occupé plus d’un an. Les administrations suivent de près la durée d’inoccupation et l’adresse du bien, car dans un contexte de pénurie, chaque toit compte.
Quel impact financier pour les propriétaires de résidences secondaires ?
Pour les propriétaires, la surtaxe change la donne. Depuis que la résidence principale échappe à la taxe d’habitation, les résidences secondaires n’y coupent pas et subissent parfois de plein fouet la hausse : en 2024, la facture moyenne atteint 1 083 euros, soit une envolée de 12 % par rapport à l’an dernier. Tout découle de la valeur locative cadastrale, révisée chaque année, puis majorée localement, le taux pouvant aller jusqu’à 60 % dans les zones les plus convoitées. De leur côté, les collectivités encaissent les recettes, qui dépassent pour cette année la barre des 3 milliards d’euros.
L’année 2026 sera également un tournant, car l’IFI nouvelle version entre en scène. Ce « futur IFI » ciblera notamment les biens considérés comme peu productifs, dont des résidences secondaires inoccupées ou mal notées sur le plan énergétique. À la clé : un taux unique de 1 % au-delà de 1,3 million d’euros de patrimoine immobilier. Ce changement promet de pousser certains propriétaires à revoir leur stratégie : faut-il louer, rénover, ou vendre ?
Dans la réalité, voici comment ça se traduit :
- À Roquebrune-sur-Argens, plusieurs collectifs de propriétaires contestent la montée en flèche de la fiscalité.
- Pour d’autres, la perspective de devoir vendre dans les zones les plus taxées sème le doute quant à l’intérêt de conserver un bien secondaire.
Loin d’un simple prélèvement, la surtaxe bouleverse désormais toute réflexion patrimoniale liée à ces logements. Son impact, combiné à l’IFI réformé et aux normes énergétiques, façonne un contexte inédit où posséder un havre de vacances suppose de bien anticiper ses choix, et d’effectuer de véritables calculs de rentabilité.
Conseils pratiques pour gérer la surtaxe et anticiper les démarches administratives
Face à cette réglementation mouvante, mieux vaut redoubler de vigilance quand on détient un tel bien. Désormais, chaque propriétaire doit signaler à l’administration l’usage du logement, qu’il s’agisse d’une résidence principale, secondaire ou d’un logement vacant. Cette étape, régulièrement négligée, détermine le montant effectivement réclamé, surtaxe comprise.
Une exonération peut parfois être obtenue, mais selon des conditions strictes : longue hospitalisation, séjour en établissement spécialisé, événement grave empêchant d’occuper son bien, sinistre ou contentieux en cours. Dans ces cas, il faut constituer un dossier solide et contacter rapidement le centre des impôts dès qu’un changement survient.
Voici quelques réflexes utiles pour éviter les mauvaises surprises :
- Consultez chaque année la valeur locative cadastrale du logement. Si elle semble incohérente, un recours administratif est possible.
- Dans une commune en zone tendue, gardez un œil sur les délibérations municipales concernant la majoration. Les taux peuvent basculer d’une année sur l’autre.
- Anticipez l’application des nouvelles règles liées à l’IFI : une résidence secondaire non louée ou énergétiquement peu performante risque de peser davantage sur la feuille d’imposition.
Une gestion efficace d’une résidence secondaire passe par un suivi administratif sans faille. La moindre omission, oubli ou déclaration incomplète peut coûter cher. S’appuyer sur un professionnel du secteur ou solliciter un conseil en cas de doute permet de gagner en sérénité, notamment lors d’un changement d’affectation du bien.
Acquérir un pied-à-terre à la mer ou à la montagne, ce n’est plus seulement choisir un lieu pour les vacances : c’est aussi faire preuve de rigueur, s’informer et parfois repenser l’équilibre entre plaisir et contraintes. Aujourd’hui, la résidence secondaire porte en elle le poids de choix collectifs et individuels, là où, hier encore, elle n’était qu’un privilège réservé aux escapades familiales.